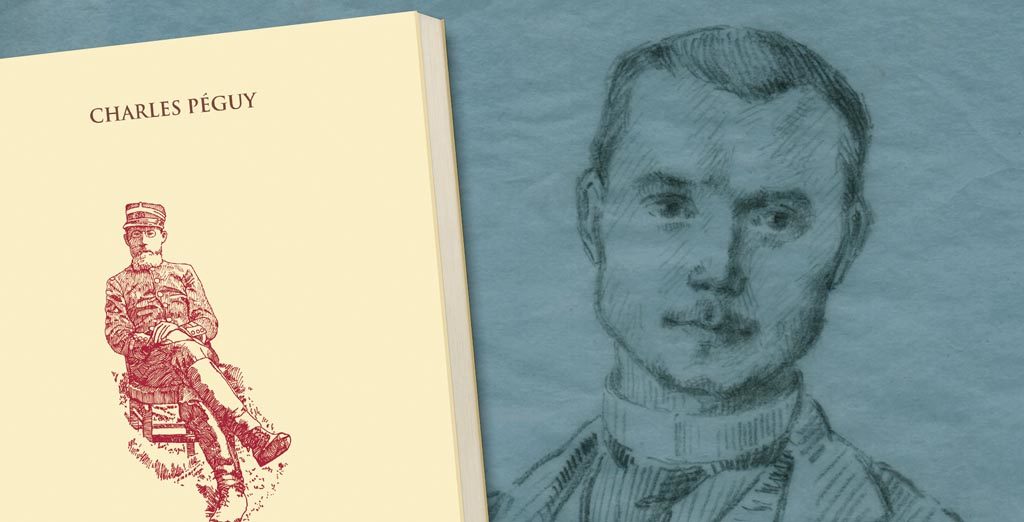
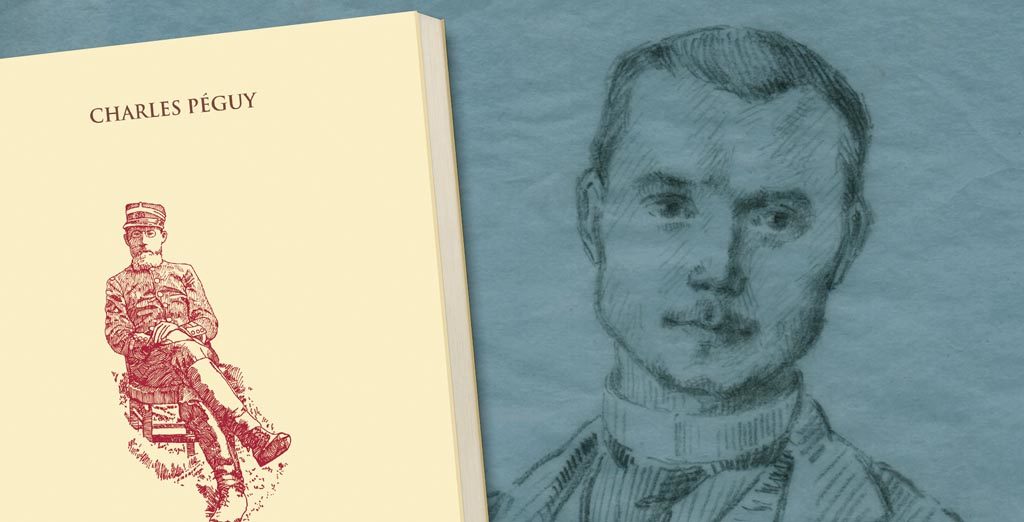
L’écrivain Charles Péguy (1873-1914)
«Tout commence en mystique et finit en politique»: la formule est si connue qu’on dirait quelque loi générale de la société découverte par un physicien de l’humain. On en vient presque à oublier qu’elle est le cœur de Notre jeunesse, œuvre qui s’inscrit dans un contexte historique précis. Et pas n’importe lequel: celui de «l’Affaire», qui reste le plus grand événement intellectuel français, et même, le moment où apparaissent le mot et la figure de «l’intellectuel». Publié quinze ans après la dégradation du capitaine Dreyfus, douze ans après le «J’accuse…!» de Zola et quatre ans après l’acquittement, Notre jeunesse, où Péguy emploie sans cesse la troisième personne du pluriel, se faisant le porte-parole d’une génération, est un manifeste, une mise au point, une façon de remettre les pendules à l’heure pour celui qui professe «la seule exactitude».
UN DREYFUSARD REPENTI?
Entre-temps, que s’est-il passé? Péguy, infatigable chef de file des dreyfusards a évolué vers le catholicisme (il refuse le mot de «conversion»). Pas de chemin de Damas ni de pilier de Notre-Dame, mais un glissement progressif, mûri d’amour de la France, de rejet de l’effroyable monde moderne, et de déception de l’utopie socialiste.
En 1910, il publie Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, drame médiéval et méditation sur la figure historique de la Pucelle et la vertu d’espérance. Méprisé par les radicaux («Péguy? Il a su mettre de l’eau bénite dans son pétrole de la Commune», dira Ernest Lavisse), le livre est encensé par les nationalistes qui voient dans Péguy un dreyfusard repenti. «Il est de chez nous!» chantent Le Gaulois et L’Action française. «Ô prodige! Voilà l’Évangile rattaché à la vie d’un jeune scolard de Sorbonne», s’enthousiasme Barrès.
C’est qu’il existe de véritables repentis parmi les dreyfusards. En avril 1910, le vieux compagnon de route de Péguy, Daniel Halévy, publie dans Les Cahiers, Apologie pour notre passé, texte plein de désenchantement où ce farouche patriote analyse la dégénérescence du parti dreyfusiste, en cédant presque tout aux nationalistes. Pris entre ces deux feux: repentir et récupération, Péguy va répondre. Ce sera Notre jeunesse, publié dans Les Cahiers en juillet 1910.
Le manifeste se veut une réaction en deux temps. Aux nationalistes, Péguy rappelle qu’il est toujours dreyfusard, et qu’il ne regrette rien: «Nous n’avons rien fait dont nous n’ayons à nous glorifier», répond-il à Halévy. Au «parti intellectuel», il martèle cette vérité: «Il est certain qu’il y a eu une trahison au moins dans l’affaire Dreyfus, et c’est la trahison du dreyfusisme même.» Il clarifie et accentue ses attaques contre Jaurès, «un retors entre les retors, un fourbe entre les fourbes».
Que reproche-t-il à son ancien camarade et ami? D’avoir exploité le dreyfusisme, de s’en être servi politiquement. Il l’accuse d’avoir, en cédant à l’anticléricalisme et à l’antimilitarisme, construit l’illusion rétrospective que le dreyfusisme était un mouvement antifrançais et antichrétien. D’avoir sali l’honneur des dreyfusistes. D’avoir servi le «combisme» (du nom d’Émile Combes, artisan de la loi de 1905 et violemment anticlérical) et l’«hervéisme» (de Gustave Hervé, socialiste qui prônait la grève générale en cas de guerre avec l’Allemagne, et que Jaurès refusa d’exclure de la SFIO).
NI JAURÈS NI MAURRAS
Contre tous les nationalistes qui virent dans le parti dreyfusard «l’anti-France» et contre les socialistes qui exploitèrent effectivement l’affaire Dreyfus à des visées anticléricales et pacifistes, Péguy veut prouver que les dreyfusards étaient des patriotes: s’ils ambitionnaient de prouver l’innocence de Dreyfus, c’est bien parce qu’ils estimaient qu’il n’y avait de tache plus infamante que d’être déclaré traître à la France. L’affaire est un point de «recoupement» entre trois mystiques: la mystique juive, la mystique chrétienne et la mystique française. Pas de «en même temps» dans cette synthèse, mais l’évidence pour Péguy d’une profonde unité de l’âme française. On présente souvent l’affaire Dreyfus comme le symptôme d’une France alors particulièrement antisémite. En réalité, et Péguy s’en veut la preuve, elle est un éclatant témoignage de l’âme de la France, de cette France éternelle, qui met son bras au service de la justice et a le sens de l’honneur.
CONTRE L’ANTISÉMITISME
Aussi faut-il rappeler à ceux qui, comme Bernard-Henri Lévy (dans L’Idéologie française), affirment qu’«il y a deux Péguy», un dreyfusard, l’autre protofasciste, qu’il n’y a qu’un seul Péguy, et que Notre jeunesse est aussi un plaidoyer extraordinairement prophétique contre l’antisémitisme. «LES ANTISÉMITES NE CONNAISSENT PAS LES JUIFS», crie Péguy (les majuscules sont de lui). Il répond point par point aux arguments des antidreyfusards. Les juifs sont-ils riches? Il n’a connu personnellement qu’un usurier, et il était, il a honte de le dire, bon chrétien. L’affaire a-t-elle été montée par le «parti intellectuel»? Péguy démonte les ressorts de ce qu’on n’appelle pas encore «complotisme». Et s’il cite ce vers du Cid: «Je rendrai mon sang pur comme je l’ai reçu», ce n’est pas pour se réclamer d’une quelconque pureté raciale, mais pour invoquer une immémoriale tradition de l’honneur. Du reste, comme l’a magistralement rappelé Alain Finkielkraut dans Le Mécontemporain: «L’amour du concret, la religion du réel, la piété à l’égard de la terre ne s’identifient jamais dans sa pensée au repli de la raison sur la région ou sur la race.»
Il va sans dire que Notre jeunesse fut très mal reçu dans les milieux nationalistes. L’éloge de Bernard Lazare, journaliste juif, dépeint comme un «saint», exaspérera L’Action française. Paul Claudel lui écrit sa déception: «Quel dommage de trouver un vrai Français, un soldat de Saint Louis combattant avec des gens qui ne sont pas de sa race contre la sienne.» Seul Barrès lui gardera son estime, et fera campagne pour lui en 1911 en vue de l’attribution du grand prix de littérature de l’Académie française pour Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (en vain).
Mais les critiques viennent aussi des dreyfusards. Ainsi Georges-Guy Grand accuse Péguy de verser dans l’idéalisme. Il remarque que la fin de Notre jeunesse a dû remplir Maurras d’allégresse: «Quel fut, en effet, le grand argument de Maurras contre les dreyfusistes? C’est qu’ils étaient des mystiques, des adorateurs de nuées, des gens perdus dans leur rêve et qui en oubliaient les réalités immédiates.»
Idéaliste, Péguy? Il s’en défend, et retourne le reproche: à ceux qui sacrifieraient volontiers l’homme Dreyfus à l’idée de la France, lui préfère l’homme à l’idée: «Un seul crime rompt et suffit à rompre tout le pacte social.» Il est décidément du côté d’Antigone contre Créon, de la vérité contre la raison d’État. Dans un texte écrit en 1905, Heureux les systématiques, Péguy se plaçait du côté des «réalistes» contre les tenants de l’esprit de système. Les réalistes sont ceux qui disent «bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse», là où les systématiques font entrer au chausse-pied le réel dans leurs cases.
ANTIMODERNE
Dans Notre jeunesse, Péguy crée une nouvelle summa divisio —on dirait aujourd’hui un «nouveau clivage»— entre mystique et politique. L’affrontement n’est plus entre ceux qui croient au Ciel et ceux qui n’y croient pas, dreyfusards et antidreyfusards, Ancien Régime et Révolution, républicains et royalistes, mais entre toutes les anciennes mystiques et le monde moderne. «Le monde qui fait le malin. (…) C’est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l’athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien.»
Halévy, Jaurès, Sorel… la vie de Péguy est jonchée d’amitiés brisées, décapitées par sa plume vindicative qui ne pardonne rien, pas même au nom de la camaraderie. Lançant ses anathèmes depuis sa ligne de crête, Péguy a quelque chose d’exaspérant, avec son style itératif qui psalmodie les raisonnements, ce style de laboureur, qui sans cesse revient dans le même sillon, creusant chaque fois un peu plus profond à peine, style qui parut inaccessible à nombre de ses contemporains.
Et pourtant, ce qu’il y a d’extraordinaire dans ce livre, c’est la force de conviction qui s’en dégage, cette sincérité de feu qu’on retrouvera chez Bernanos et Simone Weil, portée par la conscience aiguë d’être du côté de la justice. Si la jeunesse de Péguy parle à toutes les jeunesses, si ce texte si ancré dans une époque porte un message universel, c’est parce qu’il est d’abord une leçon de courage intellectuel. Il faut dire la vérité, même si elle déplaît à son propre camp. C’est aussi une mise en garde contre l’exploitation de l’événement à des fins politiciennes, et ce moment où la politique dévore la mystique dont elle est issue. C’est cela qui nous dérange et qui nous fascine chez l’auteur de Notre jeunesse: n’avoir jamais vieilli de l’âme.
Publicado por Eugénie Bastié en Le Figaro ©:

